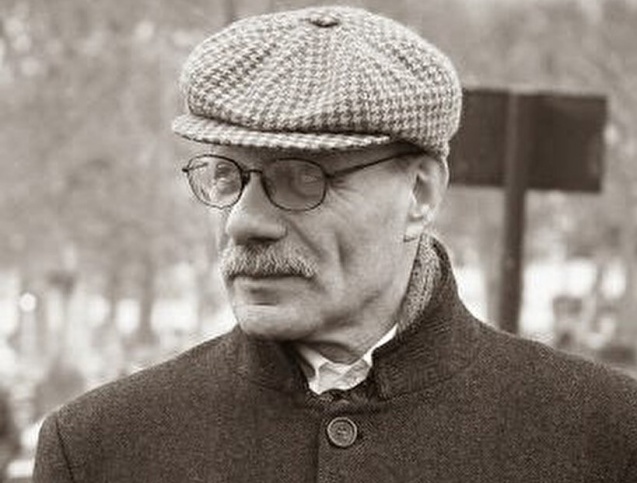Claudio Mutti è un accademico italiano — musulmano, tradizionalista ed eurasiatista. Continua a dirigere la rivista Eurasia Rivista. Mutti, la cui strada si è incrociata con quella di numerose figure di rilievo, è uno dei pensatori d’eccezione che hanno assistito in prima persona ai momenti cruciali della nostra epoca; questa è la sua prima intervista realizzata in Turchia. Abbiamo discusso di un’ampia gamma di temi che spazia da Nietzsche alla geopolitica, da Codreanu all’eurasianismo, dall’Islam all’idea di un’unità mediterranea.
Pour nos lecteurs en Turquie, pourriez‑vous vous présenter brièvement, pour ceux qui ne vous connaissent pas ? De quelle manière votre conversion à l’islam et votre lien avec l’école traditionaliste ont‑ils façonné votre parcours intellectuel et spirituel ? Comment Julius Evola et l’école traditionaliste ont‑ils influencé votre cheminement philosophique ?
J’ai pratiqué la religion catholique jusqu’à l’âge de quinze ans, lorsque l’abolition de la langue liturgique latine et la modification des rites m’ont conduit à chercher d’autres voies d’accès au sacré. Dans cette quête, les « maîtres de la Tradition » m’ont été d’une aide capitale : d’abord Julius Evola, puis René Guénon. L’œuvre magistrale d’Evola, Révolte contre le monde moderne, me présenta l’islam comme une « tradition d’un niveau supérieur non seulement au judaïsme, mais aussi aux croyances qui ont conquis l’Occident » ; quant à l’œuvre de René Guénon, elle fut pour moi la boussole d’un approfondissement supplémentaire des doctrines traditionnelles, et de l’islam en particulier. Je suis passé de la théorie à la pratique en prononçant la shahada à l’âge de trente‑trois ans.
Qu’est‑ce qui vous a poussé à écrire le livre Nietzsche et l’Islam ? Avez‑vous abordé les idées de Nietzsche d’une manière comparable aux interprétations de Muhammad Iqbal ?
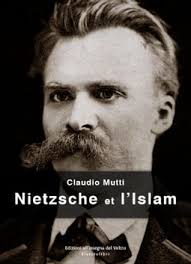
Selon Muhammad Iqbal, les exigences fondamentales exprimées par la pensée de Nietzsche trouvent leur pleine satisfaction dans la vision islamique. La Gestalt (figure archétypale) à laquelle Nietzsche donne le nom de Übermensch (Surhomme) se sublime et se perfectionne dans la notion islamique de « serviteur de Dieu ». En effet, le « Surhomme » islamique, cet homme parfait (al‑insān al‑kāmil) dont le Prophète Muhammad est l’exemple, est appelé ‘abd, « serviteur », au moment même de sa plus haute exaltation (Coran, XVII, 1), lorsqu’il est transporté vers le Trône divin. L’Übermensch est donc, selon Iqbal, celui qui identifie pleinement et activement sa propre volonté avec la Volonté divine. D’ailleurs, dans la pensée de Nietzsche, il existe d’autres notions fondamentales qui, comme celle d’Übermensch, trouvent un écho précis dans la doctrine de l’islam. C’est le cas, par exemple, de la formule amor fati, pivot central de la conception nietzschéenne de la vie. Caractéristique de l’islam est la conscience de la dépendance totale de la manifestation à l’égard de son Principe divin : d’où l’acceptation confiante, par le musulman, de tout ce qui advient dans l’univers. Cette attitude, qui n’exclut nullement la responsabilité individuelle et s’accorde parfaitement avec l’action, pourrait à juste titre être définie par référence à l’expression nietzschéenne amor fati, surtout lorsque l’acceptation sereine du décret divin (fatum) se traduit en amour pour Allah.
Corneliu Zelea Codreanu est une figure importante de l’histoire roumaine, notamment en tant que fondateur de la Garde de Fer. Comment les idées et les actions de Codreanu se rapportent‑elles à vos opinions sur le nationalisme et le traditionalisme ?
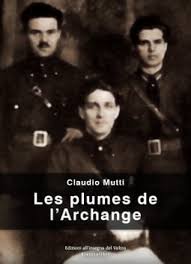
La Garde de Fer (la Légion de l’Archange Michel), dont le nationalisme et le traditionalisme consistaient en un lien étroit avec les traditions du peuple roumain, n’était pas un parti politique au sens moderne du terme, mais un mouvement animé d’un élan religieux, presque mystique ; il n’est pas surprenant que de nombreux prêtres orthodoxes aient milité dans ses rangs. L’éthique légionnaire peut être qualifiée d’ascétique et chevaleresque, car elle s’inspire d’un idéal de sacrifice, de dépassement de soi et de service du peuple. Dans son livre Pour les légionnaires, Corneliu Codreanu écrit que la Légion doit être davantage une école et une armée qu’un parti politique, et que cette école doit faire naître un « homme nouveau », c’est‑à‑dire un homme aux qualités de héros. Julius Evola, après un long entretien avec le Capitaine, écrivit également que « la tâche du Mouvement n’est pas de formuler de nouveaux programmes, mais de créer, de façonner un homme nouveau, une nouvelle manière d’être ».
Votre intérêt pour la géopolitique est‑il lié à la pensée traditionaliste, ou bien des raisons historiques ou intellectuelles spécifiques vous y ont‑elles conduit ?
Une réflexion de René Guénon sur la « géographie sacrée » et sur le symbolisme géographique m’a incité à me demander s’il est possible d’appliquer à la géopolitique la célèbre affirmation de Carl Schmitt, selon laquelle « tous les concepts marquants de la doctrine moderne de l’État sont des concepts théologiques sécularisés ». À mon avis, certaines notions géopolitiques caractéristiques pourraient effectivement être considérées comme des « concepts théologiques sécularisés ». Je me limite ici à un seul exemple : le mot latin limes, adopté par le lexique géopolitique actuel (au point qu’une revue italienne de géopolitique porte ce nom), désignait à l’origine une ligne de démarcation tracée entre les parcelles attribuées aux colons ; puis son sens s’élargit pour indiquer une voie militaire, voire l’ensemble des fortifications frontières de l’Empire lorsque celles‑ci n’étaient pas délimitées par la mer ou un fleuve. Le protecteur suprême du limes était le dieu Terminus, auquel Ovide s’adresse ainsi : « Tu fixes la frontière entre les peuples, les cités et les grands royaumes. » Georges Dumézil a montré que, dans l’Antiquité indo‑européenne, le nom Terminus correspondait à une qualité caractéristique du dieu souverain : la fonction de gardien suprême des limites territoriales.
En quoi le cadre géopolitique que vous avez développé diffère‑t‑il du concept d’eurasisme d’Aleksandr Dugin ?
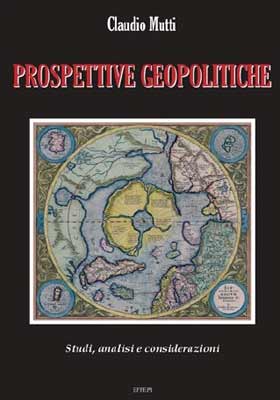
Dans la perspective géopolitique de Dugin, le Vieux Continent — c’est‑à‑dire la masse terrestre de l’hémisphère oriental — se divise en trois grandes « ceintures verticales », s’étendant du nord au sud, suivant les méridiens : l’Eurafrique (Europe occidentale et centrale, grand espace arabe, Afrique subsaharienne), la zone russo‑centro‑asiatique (ex‑URSS, Turquie, Iran, Afghanistan, sous‑continent indien), et la zone pacifique (Chine, Japon, Indonésie, Malaisie, Philippines et Australie). Cette vision géopolitique « verticale », qui sépare nettement l’Europe de la Russie, fit l’objet de critiques dans la revue « Eurasia », notamment de Carlo Terracciano, qui observa que l’Eurasie est un continent « horizontal », car elle s’étend suivant les parallèles. En termes géopolitiques, Terracciano, à rebours de Dugin, envisageait l’intégration de la grande plaine eurasienne septentrionale, du détroit de la Manche au détroit de Béring. Dans cette perspective, il est naturel que l’Europe s’intègre dans une sphère de coopération économique, politique et militaire avec la Russie ; sinon, elle sera instrumentalisée par les Américains contre celle‑ci. « S’il faut encore parler d’Occident et d’Orient — concluait Terracciano — la ligne de démarcation doit être tracée entre les deux hémisphères, entre les deux masses continentales séparées par les grands océans » ; de sorte que le véritable Occident, la terre du couchant, serait l’Amérique, tandis que l’Orient, la terre de la lumière, coïnciderait avec le Vieux Continent.
Malgré sa conception géopolitique « verticale », opposée à l’idée d’un destin commun eurasiatique, Dugin savait néanmoins que l’Eurasie est la cible de l’agression de la thalassocratie états‑unienne, intrinsèquement portée à la conquête de la domination mondiale. Mais en 2016, lors de la première campagne électorale de Donald Trump, Dugin mit de côté le point de vue géopolitique pour en adopter un principalement idéologique : il désigna l’« ennemi principal » dans le globalisme libéral et accueillit avec un enthousiasme débordant l’élection du « conservateur » et « isolationniste » Trump. « Pour moi — affirmait Dugin en novembre 2016 — il est évident que la victoire de Trump a marqué l’effondrement du paradigme politique mondial et, simultanément, le début d’un nouveau cycle historique (…) À l’ère de Trump, l’antiaméricanisme est synonyme de globalisation (…) l’antiaméricanisme dans le contexte actuel devient partie intégrante de la rhétorique des mêmes élites libérales, pour lesquelles l’arrivée de Trump au pouvoir a été un choc. Pour ses opposants, le 20 janvier a été la “fin de l’histoire”, tandis que pour nous il ouvre la voie à de nouvelles opportunités. » Poursuivant sur cette route, le 3 janvier 2020, Dugin alla jusqu’à souhaiter à Trump quatre années supplémentaires de mandat (« Four more years. Keep America great ») ; et cela le jour même où Trump revendiquait fièrement l’assassinat du général Soleimani. Ainsi Dugin a prôné une « nouvelle alliance » entre la Russie et les États‑Unis. « Les ennemis de la Russie — écrivait‑il le 20 mai 2025 sur le site “Katehon” — sont les ennemis de Trump, et les ennemis de Trump sont les ennemis de la Russie. En effet, nos nouvelles relations [entre la Russie et les USA] devraient être bâties sur ce rejet du globalisme. Et peut‑être même sur notre nouvelle alliance. »
Au‑delà de l’eurasisme, j’aimerais discuter de l’idée d’une union méditerranéenne. Pensez‑vous qu’il soit possible de créer une telle union ? Que prévoyez‑vous pour l’avenir de l’Italie et de la Turquie dans le contexte méditerranéen ?
Parsemée de bases militaires de l’OTAN et des États‑Unis — de Malaga à Sigonella, d’Alexandrie d’Égypte à Izmir et Chypre — la Méditerranée est, depuis la Seconde Guerre mondiale, un renfoncement de l’océan Atlantique, un lac pratiquement assujetti à la superpuissance nord‑américaine. S’y ajoute la présence d’un autre corps étranger, cause permanente de déstabilisation et de conflits : le régime sioniste criminel qui occupe depuis quatre‑vingts ans le territoire palestinien. Dans une telle situation, une « union méditerranéenne » n’aurait une portée décisive que si son objectif était d’expulser de notre mare nostrum ces présences étrangères. Mais quel pays méditerranéen pourrait prendre une telle initiative ? Il est certain qu’un rôle de « première ligne » reviendrait aux quatre péninsules méditerranéennes : l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la Turquie. Cette dernière, en particulier, occupe une position géographiquement cruciale, la péninsule anatolienne étant le carrefour naturel entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
Sachant que le premier numéro de votre revue « Eurasia » était consacré à la Turquie, où se situe‑t‑elle dans votre théorie géopolitique ?
La région que les Byzantins appelaient Anatolie (« terre du levant ») fut considérée dans l’Antiquité comme partie intégrante de l’Europe : Hérodote fixait la frontière orientale de l’Europe sur le fleuve Phase, près des actuels ports géorgiens de Poti et Batoumi. Au Moyen Âge, Dante plaçait « l’extrémité de l’Europe » près des montagnes d’Asie Mineure, d’où, après la destruction de Troie, l’Aigle impériale prit son essor vers l’Italie. Au XIXᵉ siècle, le géographe Élisée Reclus disait que l’Anatolie est une terre d’Asie enchâssée dans un littoral européen, tout en intégrant la partie sud‑orientale de l’Europe dans la masse continentale eurasienne. Si la péninsule anatolienne est l’extrémité la plus occidentale de l’Asie, elle est en même temps la quatrième péninsule de la Méditerranée, où elle occupe une position analogue à celles des péninsules grecque, italienne et ibérique ; par rapport à cette dernière, l’Anatolie est en position spéculaire, si bien que ces deux péninsules peuvent être considérées comme les gardiennes de la Méditerranée. Mais la Turquie n’est pas que l’Anatolie ; la Turquie, c’est aussi Constantinople, ancienne capitale de ce qu’Arnold Toynbee appelait « un empire romain turco‑musulman ». Bref, la Turquie est un pays typiquement eurasiatique, puisqu’il s’étend à la fois en Asie et en Europe. Dire que la Turquie doit choisir entre l’Europe et l’Asie crée donc un faux dilemme. À mon avis, le choix qui s’offre à la Turquie est celui entre l’Eurasie et l’Occident.
Pensez‑vous qu’une identité européenne musulmane puisse émerger, étant donné que les sentiments anti‑islamiques et antimusulmans ont souvent contribué à façonner l’identité européenne au cours de l’histoire ? Comment la droite montante et les musulmans en Europe devraient‑ils s’en approcher ?
Alors que la gauche a mis en œuvre une manœuvre insidieuse de contamination des communautés musulmanes, il n’existe de la part des mouvements de droite aucune volonté réelle de se rapprocher des musulmans, ni prédisposition en ce sens. Fondamentalement occidentaliste, la droite adopte des positions instrumentales favorables à l’islam uniquement lorsqu’il se produit une convergence ponctuelle entre une réalité musulmane particulière et des intérêts occidentaux. Ce fut le cas, par exemple, en Afghanistan à l’époque de la guérilla antisoviétique ou dans la Yougoslavie déchirée par les conflits interethniques. À l’inverse, lorsque les positions d’un peuple musulman s’opposent à celles de l’Occident, on retrouve la droite (à quelques franges négligeables d’extrême droite près) systématiquement sur des positions anti‑islamiques. Certes, la droite européenne pourrait instaurer un accord, ou au moins un dialogue, avec les musulmans en proposant une défense commune des valeurs morales attaquées par la culture dominante en Occident. Pourquoi ne le fait‑elle pas ? Par obtusité, par lâcheté, ou parce qu’elle estime que la démagogie pseudo‑identitaire est plus rentable électoralement.
Où, selon vous, le révolutionnarisme conservateur et le traditionalisme convergent‑ils et divergent‑ils ? Pensez‑vous que cette ligne de pensée puisse réellement défier ou arrêter la progression du libéralisme laïc ?
La formule de « révolution conservatrice » (Konservative Revolution), née dans les milieux allemands après la Première Guerre mondiale, visait à désigner une action destinée à éliminer une situation de désordre pour retrouver un état de normalité. Aujourd’hui cependant, compte tenu du niveau atteint par la soi‑disant « civilisation occidentale », il doit être clair qu’en Europe il reste bien peu de choses qui méritent d’être conservées. Quant au concept de révolution, s’il doit être entendu au sens étymologique du terme, il devient inévitable de penser à un « retour » (revolutio) aux principes fondamentaux que la modernité a niés. Mais alors, pour avoir du sens, le « traditionalisme » ne pourra être conçu comme le respect de formes et d’institutions résiduelles héritées du passé, mais comme l’aspiration à un nouveau commencement. Par conséquent, plutôt qu’une « révolution conservatrice », il faudrait théoriser une « révolution traditionnelle » inspirée par un « traditionalisme révolutionnaire ».
Depuis les années 1980, les attitudes postmodernes ont pris un essor considérable. Pensez‑vous que le postmodernisme ait créé un espace pour la résurgence de la tradition et du traditionalisme, ou au contraire en a‑t‑il diminué l’influence ?
La post‑modernité n’est pas le dépassement du monde moderne, mais sa phase suprême, dans laquelle le nihilisme s’accomplit par la subversion de la nature et la technologisation de l’homme, lequel est certes dépassé, mais vers le bas, en direction de l’infra‑humain. Pour résister à cet « ordre » artificiel et inversé, il faut d’abord agir sur sa propre conscience, afin d’être capable de repousser toute tromperie, toute séduction, toute tentation de reddition ou de neutralité, et se comporter en conséquence. Que la phase culminante de la modernité puisse favoriser la résurgence de la tradition peut paraître paradoxal, mais au fond c’est une perspective obligée, car de l’esprit traditionnel peut provenir la force nécessaire pour refuser la soumission à un monde irréel.
Envisagez‑vous d’écrire vos mémoires ?
Me trouvant au seuil de mes quatre‑vingts ans, je devrais écrire les Mémoires d’un octogénaire. Mais un livre portant ce titre existe déjà : Ippolito Nievo l’écrivit entre 1857 et 1858.